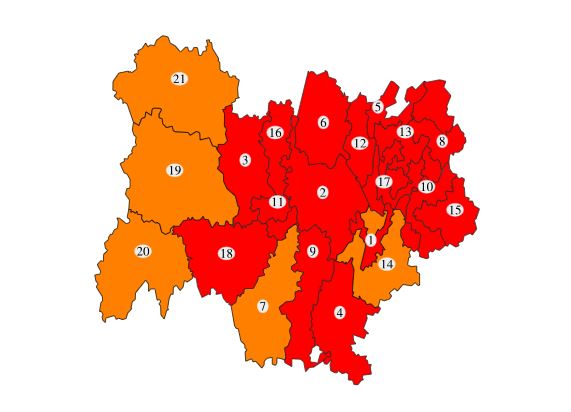Thomas Guillaume, post-doctorant, mène des recherches à l’Institut Forêt, Neige et Milieux (WSF) centre de recherche basé près de Zurich et à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Il a pendant ses travaux menés à l’Université de Göttingen, collecté avec d’autres chercheurs des données sur les phénomènes observés dans des cultures de palmier à huile en lien avec le changement climatique. Il s’est intéressé au bilan carbone de cette culture contestée.
La déforestation entraine la suppression d’un puits de carbone. Mais la plantation de palmiers recrée un puits, moins important. La production de biomasse par les palmiers recrée un stockage très momentané de carbone, négligeable sur le plan des émissions. En revanche, la productivité des palmiers à huile permet de produite une quanti de produit consommable appréciable par rapport à certains autres végétaux. Le rendement du palmier à huile est supérieur au mètre carré cultivé au rendement d’autres cultures.
Le recours à d’autres végétaux pour produire des corps gras n’est donc pas aussi évident que cela. Une espace peut avoir un rendement moindre que le palmier à huile, mais un bilan carbone plus négatif.
Il convient de prendre en compte dans l’impact carbone toute la chaine stockage-émission. Combien l’espèce cultivée stocke-elle de carbone, directement dans sa biomasse, mais aussi, indirectement dans le sol sur lequel pousse et quel est l’impact de sa culture, en incluant le travail, les produits.
Combien l’espèce fait-elle déstocker de carbone, de la déforestation à l’utilisation d’énergies fossiles?