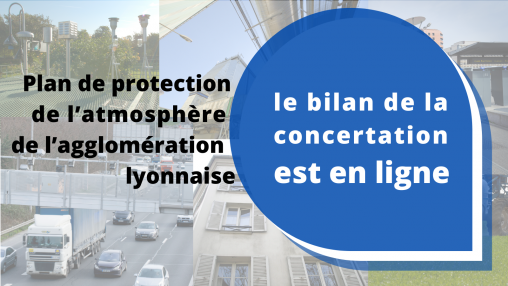L’axe fluvial Rhône-Saône pourrait être davantage utilisé pour le transport des “colis lourds”. Le transport de ces ” masses indivisibles” serait plus facile que sur les itinéraires routiers, très encombrés et certaines entreprises produisant des “masses indivisibles” seraient moins handicapées. Voies Navigables de France et la Compagnie Nationale du Rhône organisaient un colloque à Lyon( 1).
Le trafic fluvial sur l’axe Rhône-Saône a progressé en 2006 de 7,9% pour les tonnes transportées à 7,3 millions de tonnes, et de 6,1% pour le tonnes kilomètres, à 1,6 milliard de tonnes kilomètres, selon les chiffres de Voies Navigables de France. Les échanges internationaux ont progressé eux de 15,3% en tonnes kilomètres, car l’axe Rhône-Saône est aussi praticable par des bateaux fluviomaritimes qui peuvent depuis des ports de la Saône ou du Rhône, atteindre des destinations en Méditerranée, à un coût énergétique intéressant.
Si tous les compartiments du trafic fluvial progessent sensiblement, ils ont encore une marge de progression, à utiliser dans le cadre d’un report du goudron sur l’eau. Cette stratégie, peut-on penser, est intéressante à condition de ne pas combler la place libérée sur terre, par un surcroît de trafic terrestre, mais dans le sens d’une réduction des trafics.
Les avantages de la voie fluviale sont particulièrement intéressants pour le transport de colis lourds qui imposent souvent l’organisation de convois exceptionnels. Voies Navigables de France, la Compagnie Nationale du Rhône, avec le soutien de l’ADEME, de la Région, de l’Etat, organisaient ce mardi une rencontre sur ce thème important pour l’environnement, mais aussi pour l’industrie. Pour Pascal Protière, conseiller régional Rhône-Alpes, le développement du transport des colis lourds par la voie fluviale, fait partie du développement du transport fluvial soutenu aussi par la Région. ” Le fleuve est utilisé à 25% de sa capacité” explique Pascal Protière. Ce qui fait espérer à beaucoup de professionnels la création d’une liaison Saône-Moselle dont on sait qu’elle provoquera un débat.
Plus économe en énergie.
L’axe Rhône-Saône, dispose de plusieurs équipements intéressants: le grand gabarit jusqu’à Pagny, en Côte d’Or, des portiques pouvant soulever plus de 200 tonnes, des plateformes permettant de faire descendre des charges portées par des camions dans ces barges ( roll on, roll off) , sans levage. La voie fluviale est aussi plus économe en énergie et en émissions de CO2, explique Anne Estingoy, chargée du développement de la voie fluviale à Voies Navigables de France. “ La voie fluviale respecte le facteur 4“.
Bien des chargeurs sont intéressés par la voie fluviale. L’Armée de Terre elle-même, dont les coûts ne sont pas calculés comme ceux des entreprises, a utilisé à plusieurs reprises la voie d’eau, explique le Lieutenant Colonel Masson. AREVA, utilise la plate-forme Porlourd, de Chalon sur Saône, pour exporter des éléments de centrales nucléaires comme des générateurs de vapeur ou des couvercles de cuves de réacteur. Bien des entreprises de la métallurgie lourde sont intéressées pour livrer transformateurs, pièces pour l’hydraulique, pales ou éléments d’éolienne, réacteurs pour la chimie, pour l’agro-alimentaire, mais aussi engins de travaux publics, véhicules agricoles.
La voie fluviale a bien des avantages, en dehors de l’économie d’énergie: pas de contraintes réglementaires, pas de halte avec des bateaux qui naviguent 24 heures sur 24 sur l’axe Rhône-Saône, pas de vols.
Un réseau de ports hétérogène
Plusieurs obstables subsistent. Les habitudes ont la vie dure. Depuis quelques années, un texte réglementaire prévoit que les pétitionnaires d’une demande d’autorisation des convois exceptionnels ( 90 000 demandes par an) doivent d’abord étudier d’autres modes de transports que la route… … qu’ils préfèrent de toutes les manières. Le réseau des ports est aussi hétérogène. Isabelle Chauveau, chargée du transport à EDF, souligne l’absence de données sur les capacités des quais des ports pour embarquer des transformateurs de plusieurs dizaines de tonnes, alors qu’il faut s’approcher au plus près des installations.
Le principal obstacle reste l’accès routier. Les autorisations sont tès longues à obtenir. Depuis que l’Etat a décentralisé aux départements les Routes à Grande Circulation tout en gardant un oeil sur leur gestion, le temps nécessaire pour obtenir des autorisations a doublé. L’autorisation est donné par l’Equipement, qui doit en référer au département qui gère les ouvrages, et savoir si tel ou tel pont peut supporter telle ou telle charge.
Le sport avant le port
Il faut aussi tenir compte de l’accès immédiat aux zones portuaires. Patrick Diény, directeur adjoint des services du Département du Rhône et Philippe Gamon, du Grand Lyon souligne l’attention des collectivités pour préserver les accès. Mais Mathieu Duval, directeur du Port Edouard Herriot, de Lyon, constate que deux des quatres portes du Port ont été fermées, que la proximité du stade de Gerland, n’arrange pas le fonctionnement autour du Port.
Dans une économie d’échanges, où les bassins industriels ont besoin de produire, de faire face à la concurrence, d’exporter des fabrications de haute technologie, le transport de colis lourds est un enjeu économique et social, ont souligné les responsables de la voie fluviale. Alain Ratinaud, directeur du Développement de la Compagnie Nationale du Rhône ( et les membres de l’association Promofluvia) ont promis de faire passer des propositions pour le Grenelle de l’Environnement.
1) La matinée a été animée par Michel Deprost, d’Enviscope.