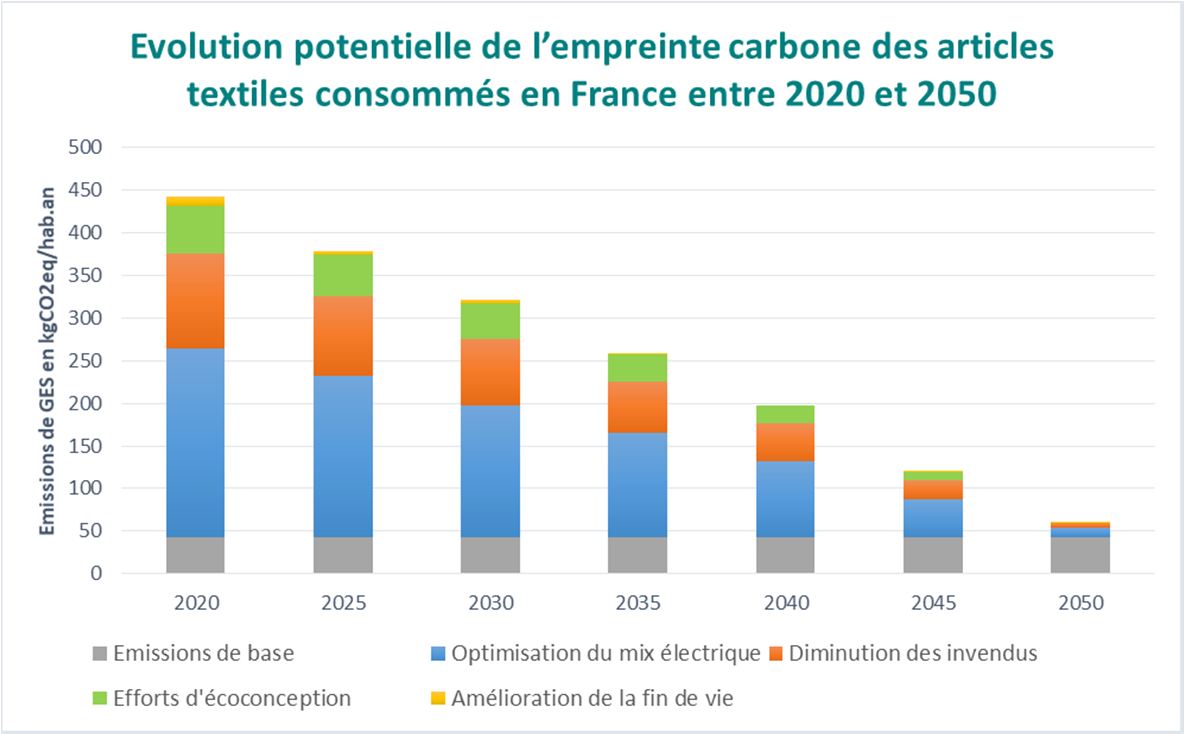Les éruptions caldériques, l’un des phénomènes les plus destructeurs, ne durent que quelques heures à quelques jours mais libèrent des dizaines aux milliers de kilomètres cubes si bien que le volcan s’effondre sur lui-même, formant une caldéra.
De telles éruptions se produisent rarement mais leurs effets sont dévastateurs aux échelles locales et mondiales. Les écoulements pyroclastiques inondent le terrain autour du volcan et détruisent tout sur leur passage. Une telle éruption s’est produit sur l’île de Santorin (Grèce) à l’âge de Bronze, et les tsunamis créés par l’entrée des écoulements pyroclastiques dans la mer, et par l’effondrement de la caldera, ont peut-être impacté la civilisation minoenne en Crête, 100 km au sud.
Les volcans de Yellowstone (Etats-Unis) et Campei Flegrei (Italie, près de Naples) ont eu des éruptions caldériques il y a 640 000 et 39 000 ans, respectivement. Quelques éruptions caldériques se sont produites historiquement comme celle Mont Pinatubo, Philippines en 1991 mais les longues phases précurseur n’ont jamais été suivies par l’instrumentation moderne. En conséquence, les phénomènes précurseurs associés à de tels événements ne sont pas connus.
T.H. Druitt (Clermont-Ferrand) et des collègues de Singapour, Nancy (France), Orléans (France), et Genève (Suisse) ont utilisé le zonage chimique des cristaux dans les produits ponceux de l’éruption du Volcan Santorin pour comprendre les processus pré-éruptifs et leur échelles de temps. Ils ont étudié les éléments tel que le magnésium, le strontium et le titane présents en quantités traces dans le feldspath plagioclase. Ils ont étudié le taux de diffusion et de rééquilibrage de ces éléments lors d’un changement en environnement (pression, température, composition magmatique) d’un cristal. Les résultats donnent des informations sur la vitesse à laquelle les grands systèmes caldériques passent de l’état quiescent à l’état éruptif.
Malgré le grand volume de magma produit (40 à 60 kilomètres cube), et les 18 000 ans depuis la précédente grande éruption du Santorin, la plupart des cristaux du magma ont enregistré des processus datant moins de 100 ans avant l’éruption. La raison: de gros volumes de magma au cours du siècle avant l’éruption sont entrés dans les cristaux dans le siècle qui a précédé l’éruption. Les dernières phases d’assemblage des grands réservoirs magmatiques peuvent se produire sur les échelles de temps géologiquement très courtes par rapport à la période de repos précédente, avec des phases de croissance importantes peu avant l’éruption.
Ces observations sont utiles pour la surveillance des caldéras en état de repos prolongé. Des taux d’intrusion magmatiques élevés, maintenus sur quelques décennies, sont peut-être nécessaires pour ‘conditionner’ les grands réservoirs magmatiques avant éruption. La réalimentation rapide du réservoir est nécessaire pour la fracturation des roches encaissantes, la propagation d’un filon de magma visqueux vers la surface et l’initiation de l’éruption. La surveillance à long terme des grands systèmes caldériques en repos est nécessaire pour que une telle phase de croissance rapide du réservoir magmatique, maintenu pendant quelques décennies, puisse être détectée bien avant une grande éruption explosive.
Decadal to monthly timescales of magma transfer and reservoir growth at a caldera volcano, Nature (in press)T.H. Druitt. Clermont Université, Université Blaise Pascal, Laboratoire Magmas et Volcans.
Decadal to monthly timescales of magma transfer and reservoir growth at a caldera volcano
T. Druitt, F. Costa, E. Deloule, M. Dungan, B. Scaillet
Nature (in press)
Les éruptions caldériques sont l’un des phénomènes les plus destructeurs sur Terre. Des éruptions individuelles ne durent que quelques heures à quelques jours seulement, mais elles libèrent tellement de magma (des dizaines aux milliers de kilomètres cubes) que le volcan s’effondre sur lui-même, formant une vaste dépression (une caldéra). De telles éruptions se produisent rarement à l’échelle de temps humaine, mais leurs effets sont dévastateurs aux échelles locales et mondiales. Les écoulements pyroclastiques inondent le terrain autour du volcan et détruisent tout sur leur passage ; d’énormes panaches de cendres et d’aérosols acides s’étalent dans la haute atmosphère et perturbent le climat global.