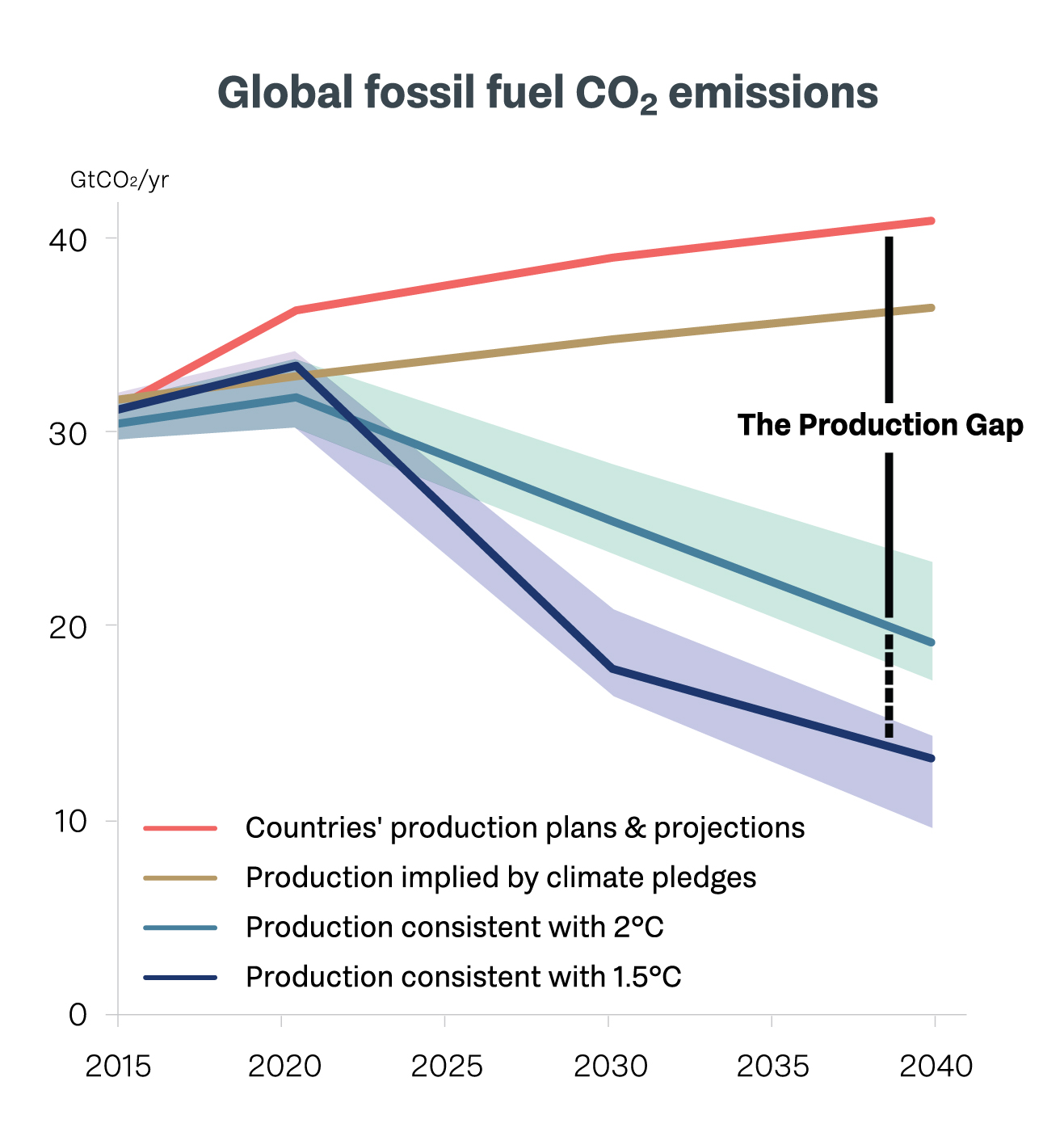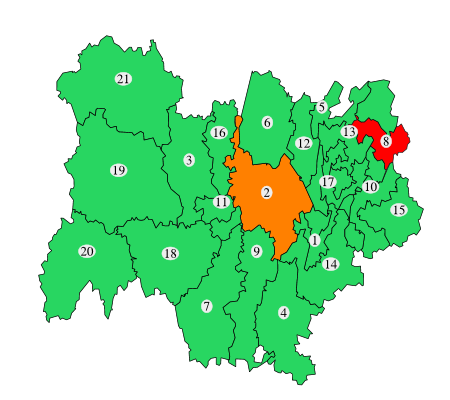L’évolution de la pollution de l’air est devenue une préoccupation constante, la population s’en inquiète, comme d’ailleurs les pouvoirs publics. Or, et notamment dans les vallées alpines au relief tourmenté, les phénomènes qui entrent en jeu sont complexes. Ils conjuguent ce que l’on appelle la dynamique de l’atmosphère qui assure le transport et la dispersion des polluants, et des interactions chimiques entre les composés nocifs de l’atmosphère, des rejets dus au trafic routier, aux activités domestiques et industrielles.
Comment l’air circule, “s’écoule” dans nos vallées, comment se font les mélanges et où, comment les polluants se concentrent et où, telles sont quelques unes des questions auxquelles essaie de répondre l’équipe ERES dirigée par le professeur Chantal Staquet.
Le facteur de la topographie
Chaque vallée possède une entrée et, le plus souvent, une sortie, des pentes et des reliefs différemment accentués, des zones d’ensoleillement et d’ombre qui évoluent au cours de la journée, des taux d’humidité, de pression, et des températures variables, qui lui sont propres. Pour comprendre les écoulements d’air, connaître les zones de mélange, de turbulences et de dispersion des polluants, les chercheurs ont recours à la modélisation numérique.
Les études portent sur la couche limite atmosphérique : c’est la partie de l’atmosphère directement influencée par la surface terrestre. Son épaisseur varie de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres, en fonction de l’ensoleillement et de la saison. Le vent y est turbulent, turbulence plus ou moins marquée par le type de surface. L’étude de la couche limite de l’atmosphère et des turbulences, indispensable dans la compréhension de la dispersion des polluants, est donc d’une grande complexité.
La simulation numérique de la qualité de l’air est usuellement réalisée à grande échelle, et sur des reliefs moins complexes.
Un mix de modèles
L’équipe grenobloise utilise des codes de calculs complémentaires pour ses modélisations numériques, outil de recherche aujourd’hui privilégié dans la plupart des domaines de la géophysique et des sciences de l’environnement. Elle se base sur des codes français (développé par Météo France) et américain, qui calculent les champs de vitesse, température, pression et humidité à différentes échelles décroissantes, façon poupées russes, jusqu’à une échelle très fine. Ces simulations destinées à résoudre les équations du mouvement sur ordinateur sont couplées à des codes de chimie qui modélisent les processus chimiques de l’atmosphère. Ce dialogue et ce partage de compétences scientifiques et techniques entre chercheurs, la mise au point d’une plateforme de calcul commune ont déjà été expérimentés dans les vallées de la Maurienne et de Chamonix, lors du projet POVA ou Pollution des vallées alpines, à la suite de l’incendie du tunnel du Mont Blanc. L’un des objectifs de POVA était de comparer les niveaux de pollution dans les deux vallées durant la fermeture du tunnel et après sa réouverture.
Une application grenobloise
C’est une autre vallée que souhaite regarder l’équipe ERES aujourd’hui en dressant une carte des coefficients de transport de polluants selon les types de temps à Grenoble.
La pollution d’origine humaine est plus importante en hiver qu’en été (chauffage des logements). En été, le rayonnement solaire accroît la concentration d’ozone mais les polluants sont davantage dispersés. En hiver, l’air froid stagne au niveau du sol, il n’y a pas de brassage et la pollution atmosphérique n’est pas dispersée. La température, très froide au niveau du sol, croît avec l’altitude mais finit par s’inverser pour décroître lorsque l’on continue de s’élever : c’est le fameux phénomène d’inversion des températures. On parle alors de conditions stables, -que l’on rencontre la nuit et en hiver lorsque le sol est froid. Cette stabilité n’est pas propice aux turbulences, et s’il n’y a pas de vent, hormis des vents de pente descendants, il semble difficile de faire intervenir la mécanique des fluides !
C’est pourtant précisément à ce casse tête que l’équipe grenobloise souhaite s’attaquer lors d’une prochaine campagne hivernale, en collaboration avec des chimistes et des physiciens du site grenoblois. Car les chercheurs soupçonnent la présence d’ondes internes piégées, susceptibles de déferler et de produire malgré tout des turbulences.
En réalisant des profils verticaux à différents endroits, en mesurant notamment températures, vitesses et concentration d’ozone, en les comparant aux simulations numériques et en couplant le modèle physique au modèle de chimie, les chercheurs espèrent comprendre les processus qui conduisent à la turbulence. Avec pour objectif la compréhension et la caractérisation des processus de transport et le mélange de polluants dans les couches atmosphériques stables.
Les chercheurs ne sont pas là pour faire de l’alerte, comme le rappelle Chantal Staquet. Mais leurs travaux permettent de dresser des modèles de comportement de vallées. Aux pouvoirs publics ensuite de s’en inspirer pour construire leurs projets d’aménagement. Est-il utile par exemple de projeter une voie rapide, un tunnel ou la construction d’un gros équipement si les polluants stagnent à tel ou tel endroit ? Sans compter l’impact sur la santé humaine de la pollution chimique atmosphérique.