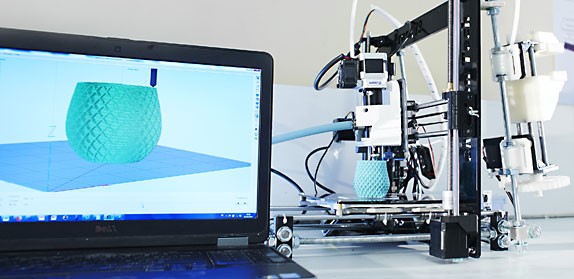Les plantes soumises à des stress stockent davantage de ressources, et plus généralement elles investissent plus dans les organes souterrains. Elles deviennent capables de mieux se régénérer que des plantes issues de milieux moins stressants.
Pour vérifier cette hypothèse, Gudrun Bornette directrice de recherche au CNRS a réalisé une expérience en collectant des spécimens de plantes collectés dans quatre habitats rangés selon un gradient de stress trophique croissant, dans deux conditions de stress mécanique généré par le courant.
L’expérience a été concluant. Les plantes les plus stressées ton développé des réserves souterraines plus importantes. Et leurs rhizomes montraient un taux de survie très supérieur à celui de rhizomes issus de milieux moins stressés, malgré une biomasse absolue beaucoup plus faible. Les plantes ayant subi un stress mécanique présentent une vitesse de croissance supérieure aux plantes qui ne l’ont pas subi pour les milieux riches en nutriments. La tendance inverse est observée en milieux pauvres où les plantes qui ont subi un stress poussent plus vite que les autres.
Connaître le comportement des espèces
Connaître la biodiversité a longtemps consisté à identifier les espèces, à les dénombrer, à recenser tous les végétaux et tous les animaux qui peuples un milieu. Gudrun Bornette et ses collègues vont plus loin en réalisant un projet permis par le cluster recherche Environnement sur la biodiversité.
Les chercheurs s’interrogeait sur la mesure de la biodiversité. Le Cluster Recherche Environnement leur a donné les moyens d’aller plus loin. « Le cluster permet de pousser notre travail sur trois thèmatiques, explique Gudrun Bornette, dans son bureau de l’Université Claude Bernard Lyon 1 « La première thématique, est celle de l’impact de l’homme sur les habitats. La deuxième concerne la manière dont les plantes modifient l’écosystème qui les entourent, la troisième s’intéresse à la manière dont l’Homme peut gérer la biodiversité ».
Pour mieux connaître l’impact de l’Homme sur les habitats naturels, il faut aller au delà de la connaissance des impacts physiques ou chimiques. La vitesse du courant dans une rivière coupée par des barrages ou des ouvrages d’art, des berges rectifiées: tout cela a un impact sur les espèces qui vivent dans un cours d’eau. Comme ont un impact les polluants provenant des stations d’épuration, des chaussées ou de l’agriculture. Comme a une influence le changement climatique, qui accroit les températures, modifie l’hydrologie, le régime des saisons, des assecs, des crues.
Les spécialistes disposent d’un cadre théorique pour comprendre l’évolution de la biodiversité, en regardant comment les espèces évoluent en fonction des ressources. en traçant un diagramme à deux axes, l’un pour les ressources et l’autre pour la stabilité, Gudrun Bornette explique quelques principes. « Un milieu stable et riche en ressources va permettre le développement d’espèces de grande taille, ce sont les arbres, la forêt. Un milieu pauvre en ressources, mais stable n’autorise que des espèces à croissance lente, économes en consommation et en rejet de carbone. Des milieux instables ne permettent que la croissance rapide d’espèces tolérantes au stress. Et des habitats pauvres en ressources et instables sont désertiques.» explique Gudrun Bornette
Comprendre l’impact des plantes
Le deuxième thème permet de mieux comprendre comment les plantes ont un impact sur leur environnement, par l’absorption et le rejet du carbone qui permet aux végétaux de se construire, et par là même aux animaux aussi de se nourrir. « La manière dont les végétaux captent le carbone, et le remettent à disposition en se décomposant est très variable, et nous cherchons à comprendre quel rôle jouent aussi les microorganismes, avec l’aide de l’oxygène, dans la décomposition du carbone».
Avec des acteurs de terrain
Ces connaissances ont un objectif: aider à la mise en place d’actions en faveur du maintien de la diversité. Les travaux menés dans le cadre du Cluster Recherche Environnement devaient s’appuyer sur des partenaires de terrain, associations ou professionnels, pour déboucher sur des résultats fondamentaux, mais aussi utilisables.
Ainsi Agnès Janin, doctorante consacre sa thèse l’étude de l’impact de l’évolution des paysages dans les boucles du Rhône, sur les populations de batraciens, par ailleurs en érosion rapide. D’autres travaux se sont déroulés sur des prairies d’altitude, près du col du Lautaret, ou dans la Dombes. D’autres recherches ont été consacrées à l’étude de trois espèces de balanins, des insectes parasites de fruits à coque comme la noisette ou la châtaigne. Les travaux devraient aboutir à la mise au point de méthodes de lutte biologique, seules capables de protéger les cultures sans casser la pyramide de la chaine alimentaire.
Pour en savoir plus sur le Cluster Environnement: