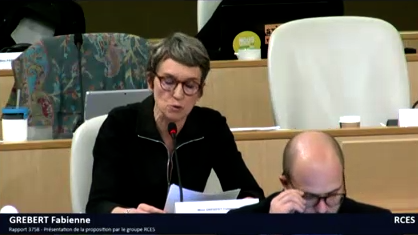EN 2007, la hausse du prix des aliments pour bétail a été de 63% mais le revenu des éleveurs a baissé de 18 % selon les statistiques du Ministère de l’Agriculture, citées par Gérard Leras, président du groupe des Verts au Conseil régional. Cette situation montre la dépendance dans laquelle l’élevage est arrivé en réduisant l’utilisation de l’herbe et autres ressources locales, au bénéfice d’aliments produits de plus en plus loin.
Aux excès d’un système, s’ajoute depuis quelques années, les conséquences des évolutions climatiques notables en Rhone-Alpes. « Dans certaines vallées de la Maurienne, des agriculteurs de réalisent plus qu’une fauche de luzerne ou deux, où ils arrivaient à en faire deux trois quand la pluviométrie était très bonne » explique Gérard Leras. Les années 2003,2004 et 2005 ont été sèches. Ce qui dans certains secteurs a conduit à réduire les emblavements en maïs. Des secteurs de la Drôme, dans les Collines ou de l’Isère, dans le Trièves, sont devenus séchants.
Ce constat a conduit le Conseil régional à engager une réflexion dans plusieurs directions. L’objectif : accroître l’autonomie alimentaire des élevages, en encourageant l’utilisation de ressources locales, mais aussi en favorisant le recours, quand des importations sont nécessaires, à des produits sans OGM. « Il faut se passer d’OGM en montrant que d’autres solutions existent, en rappelant que l’élevage est le principal consommateur d’OGM, avec le soja» explique Gérard Leras.
Les ruminants d’abord
Le groupe de travail animé par Gérard Leras concentre son action sur les ruminants, laissant pour le moment de côté porcins et volaille. Il réunit des représentants du GIE Ovin de Rhône-Alpes, du Pôle Expérimental Bovins Lait, de l’Union des Contrôles Laitiers de l’Isère, de l’Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Rural/ARDEAR, des chambres d’agriculture, de l’institut de l’élevage …
Trente diagnostics.
La première action consiste à lancer des diagnostics sur une trentaine d’installations. Le groupe a réalisé des visites. Des pistes se dégagent, pour redonner toute sa place à l’herbe. Il faut par exemple rendre une cohérence foncière à des exploitations dont la localisation des parcelles rend difficile la mise à l’herbe des animaux. Il faut réaliser des bâtiments de séchage, utiliser des unités de traite mobiles qui permettent d’aller chercher le lait sans avoir à ramener les bêtes à l’étable.
Il faut aussi varier les cultures, pratiquer des assolements en introduisant en alternance avec des céréales, des protéagineux, cultiver de nouveaux luzerne, lotier, sainfoin, produire du méteil, un mélange de céréales (blé, orge, avoine) et de pois fourrager, de la vesce. La production locale de protéagineux peut même être une alternance à la culture du maïs menacé par la chrysomèle. En effet, les larves de ce redoutable ravageur (détecté en 2007 dans trois foyers de Rhône-Alpes) peuvent passer l’hiver et profiter de nouvelle culture de maïs le printemps qui suit leur naissance. Elles ne survivront pas si une autre culture est mise en place. Une expérimentation va être mise en place dans 7 communes du Haut Grésivaudan où déjà les agriculteurs ont opté pour la rotation dans leur lutte contre le risque de chrysomèle.
Voisinage et coopération
L’idée est d’utiliser au maximum les ressources des territoires, aussi par le biais d’entraide de voisinage et de coopération. Un éleveur doit pouvoir s’adresser plus facilement à un collègue pour valoriser une ressource de proximité.
Un des enjeux soulever par le groupe de travail est l’approvisionnements extérieurs sans OGM. Une délégation rhonalpine constituée de représentants de la Région , de la chambre régionale d’agriculture et de la coopérative la Dauphinoise s’est rendu en avril dans l’Etat du Paraná au Brésil. « Le Paraná exerce des contrôles très stricts sur les filières et développe la filière non OGM. Nous recherchons des unités de trituration de tourteau de soja capables de fournir des quantités suffisantes. Il est inutile d’importer de l’huile ! » explique Gérard Leras. Le montage d’une filière d’importation suppose la mise en pace d’un transport par bateau, avec arrivée à Sète, des volumes suffisants. Il faut trouver des débouchés en France, peut-être au-delà de Rhône-Alpes.
Quelle que soit la solution pour ce volet d’approvisionnement, le Conseil régional prendra à l’automne les premières mesures de son plan pour l’autonomie alimentaire des élevages.